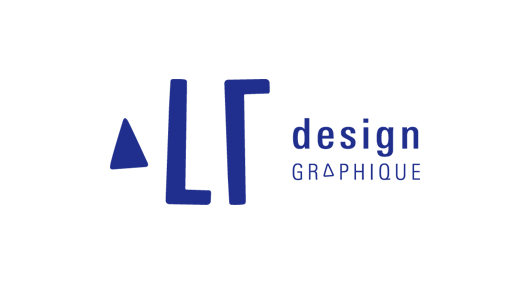La Charte de la Mutualité (1900) inaugure la constitution d’un ensemble d’acteurs socio-économiques œuvrant dans les domaines de la protection sociale. Mutuelles, Institutions de prévoyance, Groupes de protection sociale, et dans une moindre mesure Assurances, interviennent, depuis en 1945, en complément de la Sécu… Des unes aux autres, le mouvement de continuité dans l’esprit se conjugue avec une concurrence dans les faits actée par les pouvoirs publics pour faire face aux besoins en santé croissants de la population, salariée ou non.
La question de prestations de protection sociale pour les travailleurs se pose bien avant la création d’une Sécurité sociale publique, en 1945. Et ce même si l’ordonnance du 2 octobre de la même année (Gouvernement provisoire de la République) créée l’institution de référence en la matière. Généralement, on s’accorde sur le fait que des organismes dédiés ont émergé dès le Moyen Âge, en lien avec les corporations professionnelles, confréries, le compagnonnage, pour connaître un développement certain dès le XVIIIe siècle. La puissance publique n’est pas étrangère au mouvement, puisqu’elle créé aussi des dispositifs pour les marins (secours viagers) et militaires (Invalides).
Montée en puissance et institutionnalisation du mouvement de « secours mutuel »
Le phénomène connaît un coup d’arrêt avec les grandes lois libérales de la Révolution (décret d’Allarde, loi le Chapelier) interdisant les corporations et autres collectifs professionnels. Durant la première moitié du XIXe siècle, il continue à se développer dans l’illégalité, essaimant au sein de collectifs syndicaux (patronaux, de travailleurs), et ne concernant que des franges très limitées de la population. La question sociale, sinon aggravée du moins reconsidérée dans le contexte de la Révolution industrielle, et synonyme d’une montée en puissance de la revendication ouvrière, mais aussi côté patronat d’un intérêt à conserver sa main d’œuvre, interpelle aussi les pouvoirs publics. Une mutualité impériale voit ainsi le jour sous le Second Empire (décret du 28 mars 1852), dont l’objet est à la fois de développer les services de protection sociale (maladie, retraite) et de contrecarrer les initiatives des acteurs privés, notamment les tenants des idées socialistes.
La IIIe République reconnaît l'œuvre nationale des sociétés de secours mutuel
Il faut néanmoins attendre la IIIe République, à travers les lois ré-autorisant la constitution de groupements collectifs professionnels (lois de 1864 et 1884), mais aussi relatives à la protection sociale (assistance médicale gratuite, accidents du travail), pour qu’une institutionnalisation de fait intervienne avec la loi de 1898 sur les sociétés de secours mutuels. C’est aussi avec le soutien de l’État que la Mutualité française (aujourd’hui Fédération nationale de la mutualité française), créée en 1900, s’installe au Musée social, considérant que «La Mutualité accomplit une œuvre véritablement nationale en particulier en luttant contre la maladie». De plus, la loi habilite ces «associations de prévoyance» à accorder des prestations de «maladie, blessures ou infirmités, (…) pensions de retraites, (…) assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d’accidents, pourvoir aux frais des funérailles et allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins», ainsi que «créer au profit de leurs membres des cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage» (article 1 de la loi du 1er avril 1898).
La recomposition issue de la création de la Sécurité sociale
Le large champ d’intervention des structures anticipe donc celui de la Sécurité sociale, en même temps que le mutualisme préfigure le modèle du paritarisme à la française. Toutefois, l’État, via les lois sur les retraites paysannes et ouvrières (1910), puis sur les assurances sociales (1928, 1930), commence à préfigurer un modèle public «obligatoire» au sein duquel les acteurs non publics sont instrumentalisés ou contraints de céder de leurs prérogatives (périmètre, missions, gouvernance), quant ils ne sont pas écartés. D’où des conflits d’intérêt et les réticences de ces derniers à souscrire aux politiques publiques.
La révision obligée du rôle des mutualistes
L’institution de la Sécu même si le système imaginé n’a pu être concrétisé (survivance de régimes spéciaux, autonomes, agricole), se joue contre la Mutualité, moins parce que le mouvement a soutenu la Charte du travail du régime de Vichy, que parce que ses valeurs (volontariat d’adhésion, liberté d’affiliation, indépendance vis-à-vis de l’État) ne sont pas partagées par les acteurs publics, tandis que les syndicats de salariés démultiplient leurs points d’ancrage dans le dispositif émergent: gestion de la Sécu et implication forte dans la création de mutuelles d’entreprises et de fonctionnaires, rôle dans les nouvelles institutions de prévoyance.
Bien qu’il continue à essaimer, le mouvement mutualiste commence à voir sa légitimité (abrogation de loi de 1898 par le Code de la mutualité en 1955; exclusion de la Sécurité sociale en 1967) et périmètre d’action se réduire, ce d’autant que le nombre d’acteurs sur le champ de la protection sociale complémentaire s’ouvre: compagnies d’assurances (assurance des risques lourds depuis 1929), sociétés mutuelles d’assurances, institutions de prévoyance.
Les institutions de prévoyance, auxiliaires de la Sécurité sociale
Héritières des organismes de prévoyance collective d’entreprise ou encore de sociétés d’assurance, et instaurées par décret du 8 juin 1946 (IVe République), les institutions de prévoyance (IP) sont habilitées à servir des droits établis par convention collective (nationale, de branche) et sur le principe de l’adhésion obligatoire, en matière de retraite et prévoyance, ce qui les différencie des mutuelles. Plus ancrées dans le régime de sécurité sociale (et régies par son Code), les IP consacrent la prise en mains de l’assurance sociale par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés, via l’articulation (agrément obligatoire) à la création de l’Association de gestion de le retraite complémentaire des cadres (Agirc, 1946, et désormais de la fédération Agirc-Arcco). Dès les années 1950, elles interviennent aussi sur le domaine quasi réservé des sociétés de secours mutualistes en matière de complémentaire santé.
Entre crise de la Sécu et intégration européenne: le paysage libéralisé de la prévoyance
Structuré autour du monde du travail, conforté par la croissance des Trente Glorieuses, le modèle de sécurité sociale à la française apparaît néanmoins en crise dès la fin des années 1960; crise qui ne fera que s’accentuer dans les décennies suivantes. D’où il résulte notamment que les pouvoirs publics se trouvent contraints d’élargir le champ de l’intervention providentielle, en lien avec la montée en puissance de la précarité (économique, sociale, de santé) et corrélativement d’une attente plus forte de service personnalisé (notamment en matière de santé, pour cause en particulier de vieillissement de la population) mais aussi de l’érosion des solidarités économiques et sociales collectives.
Et cela tout en assumant les conditions d’une intégration européenne plutôt orientée libéralisme, en matière de dépense publique, de services concurrentiels et de niveau acceptable de prélèvements obligatoires (essentiellement captés sur le système productif: entreprises, salariés, au risque de pénaliser sa compétitivité). Témoin les multiples reconfigurations sinon réformes de la sécurité sociale, des retraites, de l’assurance chômage. De nombreux observateurs notent que le volontarisme décisionnel étatique a été d’autant plus prégnant que les moyens concrets d’intervention se réduisaient, au risque d’affaiblir, par ses injonctions, des corps intermédiaires économiques et sociaux également affectés par une crise de légitimité mais qui restent pourtant des acteurs incontournables d’un système négocié dès l’origine.
Quoiqu'il en soit, les contraintes imposées par les pouvoirs publics (en particulier ici le découplage, à partir de 1971, entre activités de retraite complémentaire obligatoires, et de prévoyance, ouvertes à la libre concurrence) se conjuguent avec une ouverture de marché des services de prévoyance qui contribue certes au développement des structures mais accroit aussi leur concurrence, notamment concernant la complémentaire santé, longtemps «chasse gardée» des mutualistes, mais ouverte dès 1956 aux autres acteurs. Mais, suivant la même logique, le Code de la mutualité de 1985 ouvre aux mutualistes le champ de la prévoyance collective complémentaire. La mutation de l’ensemble du secteur en «entreprises» génère à la fois des effets de concentration, de filialisation (version mutualisme, assurance mutuelle…) de rapprochement, autour d’une offre de prévoyance globale.
Les Groupes de protection sociale: un nouvel acteur intégratif sur le marché
L’émergence des groupes de protection sociale (GPS), entérinée par un accord entre partenaires sociaux du 25 avril 1996 et consolidée par un accord du 8 juillet 2009, est significative de cette évolution. Un GPS regroupe ainsi «des institutions de retraite complémentaire Agirc et Arrco, des institutions de prévoyance, unions d’institutions de prévoyance et, dans la mesure où elles existent, des institutions de retraite supplémentaire qui se transformeront en institution de gestion de retraite supplémentaire, des mutuelles, unions de mutuelles et sociétés d’assurance mutuelles». Un regroupement certes encadré par une «association sommitale» et une «minorité de blocage» de la fédération Agirc-Arrco.
Une nouvelle donne sur les services « complémentaire santé » et retraite ?
L’évolution des GPS et des IP, par leur articulation à l’Agirc et l’Arrco, devrait être impactée par la réforme du système de retraite envisagée par le Gouvernement. Le processus en est toutefois suspendu à la fois pour des raisons structurelles (opposition d’acteurs socio-professionnels multiples) et conjoncturelles (crise Covid). Exacerbées par la crise sanitaire, les problématiques de santé («Ségur de la Santé») et de l’autonomie des personnes âgées conditionnent également l’avenir des GPS, IP, et aussi des sociétés mutualistes.
Les acteurs de l'offre de prévoyance aujourd’hui
Les sociétés mutualistes
Fédérées notamment au sein de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF), laquelle revendique près de 540 affiliés pour 38 millions d’adhérents, les sociétés mutualistes sont des organismes privés à but non lucratif tenus à la non-discrimination en fonction de l’état de santé de la personne, dont chaque adhérent est propriétaire. Quoiqu’ayant évolué suivant une logique d’entreprise, elles sont considérées comme des acteurs de l’économie sociale.
La prestation complémentaire santé de la Sécurité sociale constitue toujours le cœur de l’offre, mais elles procurent aussi des prestations de prévoyance (maladie, incapacité de travail, invalidité, dépendance et de décès) et gèrent un ensemble de services et d’établissements de soin et d’accompagnement (2800 hôpitaux, centres dentaires, d’audition, pharmacies, établissements médico-sociaux).
La FNMF (à statut de société mutualiste) représente le mouvement mutualiste auprès des pouvoirs publics et accompagne le développement des sociétés mutualistes. Elle essaime sur le territoire via 17 unions régionales. Sa gouvernance s’organise autour d’une assemblée générale (800 délégués), d’un conseil d’administration (40 membres), d’un bureau (16 membres), ainsi que d’une conférence nationale (réflexion et de débats). Depuis 2016, elle est présidée par Thierry Baudet.
Les institutions de prévoyance
En 2018, on recense 36 institutions de prévoyance. Ces organismes relèvent du Code de la sécurité sociale. Organismes privés à but non lucratif, les IP sont gérées par les partenaires sociaux (employeurs, salariés) et se constituent à partir d’accords collectifs d’entreprises. Elles assurent des prestations en matière de retraite, décès, incapacité, invalidité, complémentaire santé. Depuis 2006, elles sont fédérées au sein du Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP), association qui revendique 38 structures adhérentes, 13 millions de bénéficiaires via 2000 entreprises.
Le CTIP a vocation à les représenter auprès des pouvoirs publics et à soutenir leur développement. Sa gouvernance est assurée par un conseil d’administration – 30 membres issus à parité des organisations d’employeurs (CPME, FNSEA, Medef, U2P) et de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO) – lequel élit un bureau (10 membres à parité également), ainsi que d’un comité des directeurs (des institutions de prévoyance membres), instance technique d’appui au conseil d’administration. Actuellement, le CTIP est co-présidé par Djamel Souami (CFE-CGC) et Denis Laplane (Medef).
Les groupes de protection sociale
Également à gouvernance paritaire, les GPS assurent la gestion par délégation des régimes de retraite complémentaire Agirc-Arrco, ainsi que des services de protection sociale collective ou individuelle. Ils intègrent naturellement des IP, mais aussi des mutuelles, des sociétés d’assurance mutuelle, des sociétés d’assurance ou de gestion d’épargne salariale. Obligatoirement agréés par la fédération Agirc-Arrco, ces organismes sont nécessairement structurés autour d’une association sommitale pilotée par le partenaires sociaux. Leur périmètre d'intervention est plus ou moins étendu et avec lui le nombre de leurs composants d'origine ou de leurs structures opérationnnelles. On compte actuellement 12 GPS (AG2R La Mondiale, Agrica, Apicil, Audiens, BTPR (Guyane, Antilles), CRC (Réunion), CGRR (Guadeloupe), Ircem (Martinique), IRP Auto, Klesia, Lourmel, Malakoff Humanis, Pro BTP) relevant de l’interprofessionel, du multiprofessionnel ou de secteurs professionnels spécifiques.
Les sociétés mutuelles d’assurance
Les sociétés mutuelles d’assurances sans intermédiaire ressortissent du Code des assurances, sous statut de «sociétés civiles à but non lucratif», dont l’origine remonte aux années 1930 (Maif,1934). Acteurs de l’économie sociale, ces structures constituées à l’initiative de groupes professionnels, servent des prestations de prévoyance que de risques non professionnels. Elles se sont fédérées, dès les années 1960, au sein du Groupement des sociétés d’assurance à caractère mutuel, devenu ensuite Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA, 1989).
En 2016, un rapprochement s’opère avec la Fédération française des sociétés d’assurance, pour faire naître la Fédération française de l’assurance (FFA). Dans la nouvelle structure, l’Association des assureurs mutualistes, qui intègre aussi les sociétés d’assurance mutuelles (32 adhérents au total), apporte son expertise et promeut les intérêts de des adhérents. Sa gouvernance s’organise autour d’une Commission exécutive (29 membres) désignée par assemblée générale (32 membres), dont émane un bureau (9 membres). Elle est présidée actuellement par Thierry Martel, lequel est membre du bureau de la FFA en tant que vice-président (aux côtés de la présidente Florence Lustman).
Principales sources et références
-«Sociétés de secours mutuels, loi du 1er avril 1898 modifiée et complétée par les lois des 31 mars 1903 et 2 juillet 1904», Joseph Barberet, 4e édition revue et augmentée, Librairie Chevalier et Rivière; accessible en ligne sur le site BNF Gallica
- «Les grands jalons de l’histoire mutualiste», Michel Dreyfus, 2008, ERES revue Vie sociale, ISSN 0042-5605; accessible sur le site de Cairn Info
- «Histoire des complémentaires maladie», Jean-François Chadelat, École nationale supérieure de Sécurité sociale, revue Regards, 2016, ISSN 0988-6982; accessible sur le site de Cairn Infos
- «La protection sociale complémentaire en France, Aspects historiques et réglementaires, Synthèse documentaire», Marie-Odile Safon, Centre de documentation de l’Irdes, 2019; ISSN 2606-0272; accessible en ligne sur le site de l’Irdes
- «Les institutions de prévoyance en France, un panorama économique en 2001», DREES, ministère du Travail, juillet 2004, ISSN 1146-9129; accessible en ligne sur le site du ministère de la Santé
- «Les Groupes paritaires de protection sociale, Quel bilan?Quel avenir?», Jean-Marie Spaeth, Cécile Waquet; contribution aux réflexions du Cercle de l’épargne, 17 octobre 2017; accessible en ligne sur le site du Cercle de l’épargne.
- Sites: Mutualité française, Centre technique des institutions de prévoyance, Association des assureurs mutualistes